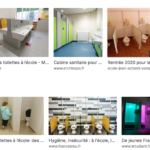Les questions liées au genre dans les courts métrages du festival « Un poing c’est court » 2016
Le 23 janvier 2016, s’achevait à Vaulx-en-Velin la 16ème édition du festival « Un poing c’est court ». Dédié aux courts métrages de l’espace francophone, ce festival met en avant la diversité sous toutes ses formes. Rien de surprenant,  donc, que plusieurs films de la compétition aient traité de questions liées au genre, que ce soit en termes d’inégalités femmes-hommes, de stéréotypes féminins-masculins ou d’orientation sexuelle, soit en sujet principal, soit en toile de fond.
donc, que plusieurs films de la compétition aient traité de questions liées au genre, que ce soit en termes d’inégalités femmes-hommes, de stéréotypes féminins-masculins ou d’orientation sexuelle, soit en sujet principal, soit en toile de fond.
La domination masculine est d’ailleurs au centre de « Bal de famille », de Stella Di Tocco, qui a obtenu le Grand Prix de cette édition. Subtilement filmé, ce film met en avant le côté pernicieux du paternalisme traditionnel sous sa forme la plus idiote et cruelle qui soit. On y voit une femme, incarnée par Sophie Vaslot, prisonnière de l’infériorisation quotidienne qu’elle subit, intégrant les humiliations au point de n’être plus qu’une esclave aux ordres de son mari. Ce dernier, joué par Frédéric Pierrot, symbolise parfaitement ces hommes despotiques qui osent exiger une forme de reconnaissance pour le bien qu’ils pensent apporter – ici, par exemple, il contraint sa femme à interrompre son repas pour présenter à sa fille la magnifique robe qu’il lui a offert, et la scène d’essayage révèle les traces de coup sur le corps de cette femme dont son mari se plaît pourtant à encenser la beauté. Les enfants complexifient la donne : la fille aînée (l’excellente Pauline Etienne) s’émancipe depuis qu’elle fait des études supérieures (entre autres, de façon symbolique, avec des cheveux courts et des tatouages) et tente désespérément d’entraîner sa mère dans son sillage ; le fils paraît emboiter le pas de son père dans certains comportements autoritaristes tout en montrant des signes de bienveillance et de remise en question ; et la petite dernière est un être fragile dont le regard semble constamment appeler à l’aide.
Ce paternalisme, si ancré dans nos sociétés, est palpable dans d’autres films de la sélection. Le film franco-kosovar « Une goutte de sang », de Bekim Guri, dénonce les mariages arrangés et la sacralisation de la virginité féminine. La fin critique de façon radicale et symbolique la violence de cet inégal traitement des femmes : le traditionnel drap tâché de sang, qu’on exhibe pour vérifier la virginité de la mariée, est ici la preuve d’une vengeance, celle de l’assassinat d’un homme dans son lit pour s’opposer à un mariage imposé.
Pour son film « Azurite », Maud Garnier choisit de se placer dans un passé non précisé pour dresser le portrait d’une jeune fille (parfaitement incarnée par Alba Gaïa Bellugi) qui tente de se poser comme la digne héritière de son père, un peintre reconnu. Comme la société dans laquelle elle vit ne favorise aucunement les filles, elle choisit la ruse comme tactique, dans l’espoir de discréditer les apprentis masculins qui pourraient succéder à son père et lui subtiliser notamment son secret (une peinture bleue faite à base d’un minerai appelé azurite). Le film montre à quel point il est complexe d’être féministe dans une société qui n’est pas prête pour ce genre d’évolution : le personnage est tantôt dans l’affirmation d’un caractère fort pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, tantôt dans un nécessaire profil bas pour ne pas être définitivement écartée par ceux qui dominent et décident.
Dans « Un métier bien » (prix du jury des grandes écoles), Farid Bentoumi montre les errances de jeunes musulmans français (plus ou moins paumés), et notamment l’hypocrisie de certains positionnements idéologiques. On y voit par exemple un jeune barbu, qui utilise constamment le Coran comme justification morale, mais qui fait preuve d’un certain voyeurisme en déshabillant une poupée Barbie. D’autre part, la vente d’objets comme les hijabs est ramenée à leur simple intérêt commercial, ridiculisant là aussi les discours d’infériorisation des femmes qui prétendent s’appuyer sur des vertus religieuses. Inversement, deux personnages, eux aussi musulmans, se montrent très critiques envers leur communauté, le père en faisant remarquer à son fils qu’il ne connaît pas les femmes du prophète et qu’il ne sait pas comment elles vivaient, et la sœur en s’indignant que son frère travaille dans un magasin de vêtements islamiques alors qu’elle-même s’émancipe et étudie à l’université.
Il est également question de traditions dans « Nkosi coiffure », de Frederike Migom, qui propose une confrontation de valeurs entre des femmes d’origine congolaise et une Flamande. Le discours des Congolaises est globalement conservateur : elles condamnent l’avortement et louent les bienfaits des rapports coutumiers entre hommes et femmes, affirmant par exemple que, si un homme entretient sa femme, ça l’empêche d’être infidèle. Si cette apologie des traditions semble dominer, on note toutefois que ces valeurs inégalitaires se fissurent quand les plus jeunes tempèrent certains propos, et la fin montre que la Flamande a su utiliser sa rencontre avec ces Africaines pour affirmer sa propre liberté.
Dans le film d’anticipation « Replika », du Suisse Luc Walpoth (qui a remporté les prix des jurys jeunes et adultes), des hommes se choisissent des femmes-robots parfaites avec lesquelles ils agissent de façon hautaine. Ironiquement, l’héroïne, une femme-robot, exprime plus de sentiments que son « mari » et se montre notamment plus préoccupé par la nécessité d’avoir et d’aimer des enfants. Inversement, le film tunisien « Père », de Lotfi Achour, lauréat du prix du jury presse et du prix du scénario, propose un personnage de père qui se retrouve à réfléchir au sens de sa paternité lorsqu’il apprend qu’il est stérile et que ses deux enfants ne sont donc biologiquement pas les siens. Le grand humanisme de ce film contraste avec certains discours qui polluent les débats depuis quelques années, montrant qu’être père (et on pourrait dire la même chose sur le fait d’être mère) n’est pas une question de lien biologique mais une posture, une construction et un choix.
Les stéréotypes de genre sont abordés de façon subtile dans le film belge « Cadillac », de Pauline Roque, grâce au personnage principal, Billie, une jeune femme garagiste qui mêle des éléments traditionnellement qualifiés de « virils » et d’autres de « féminins ». De façon plus humoristique, les très courts « Je suis marié » et « Je suis l’ombre de mes envies » se moquent de façon décalée des stéréotypes au sein des couples hétérosexuels : dans le premier, l’homme hésite entre sauver sa voiture d’un crash assuré ou son épouse bavarde d’un étouffement certain ; dans le second, l’homme est incapable de s’affirmer face à une femme autoritaire dont le seul regard suffit à faire plier son compagnon.
Enfin, la question de l’homosexualité a été au cœur de deux courts métrages, avec des angles plutôt inhabituels. Dans « Je crie ton nom », du Suisse Oskar Rosetti, il est question de la recherche du désir dans une maison de retraite, à travers le personnage d’un homme dont on comprend qu’il a été marié et qu’il a sans doute caché voire refoulé son homosexualité durant toute sa vie. La question du tabou de l’homosexualité est encore plus marquée dans le film algérien « N’sibi », de Hassene Belaïd. Dans un pays où un acte d’homosexualité peut être sanctionné par trois ans d’emprisonnement et où les violences anti-LGBT peuvent conduire au meurtre, le sujet est pour le moins délicat à traiter ! Belaïd aborde ce thème avec un mélange de gravité, d’humour et de tendresse, dénonçant la sournoiserie de la société (le personnage manque de se faire violer) tout en proposant aussi un optimisme mesuré (le beau-frère du personnage gay finit par le protéger).
Raphaël Jullien